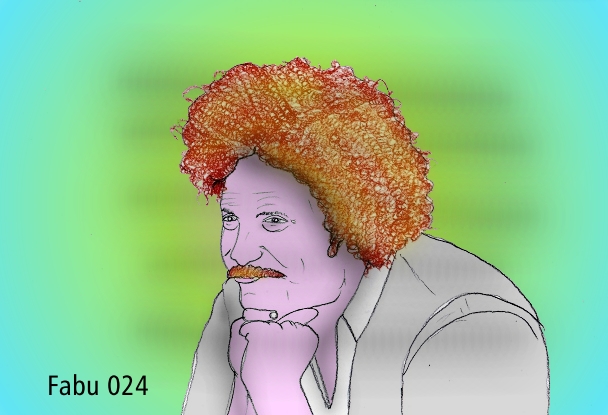Porcaro [pɔʁkaʁo] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.
Géographie
Situation
La commune de Porcaro est située sur l'axe Guer - Ploërmel.
Climat
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février.
Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.
Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Guer », sur la commune de Guer, mise en service en 1992 et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau,, où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 843,5 mm pour la période 1981-2010. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1945 et à 40 km, la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000, à 12,1 °C pour 1981-2010, puis à 12,4 °C pour 1991-2020.
Urbanisme
Typologie
Au , Porcaro est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022. Elle est située hors unité urbaine. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Guer, dont elle est une commune de la couronne,. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants,.
Occupation des sols
L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (58,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (37 %), forêts (28,4 %), prairies (12,1 %), zones agricoles hétérogènes (9,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8,4 %), zones urbanisées (2,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,5 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,5 %).
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).
Toponymie
Attesté sous la forme Porcaro en 1142 et 1598, ce nom viendrait du nom de la famille Caro, seigneurs du lieu. Le mot du breton vannetais porh (porz dans les autres dialectes bretons) signifie selon l'abbé J.-M. Le Claire (1915), qui écrit porch, "habitation importante avec cour et portail", et d'après d'autres auteurs, plus généralement "cour de ferme, demeure" ou simplement "cour",,.
Pour H. Abalain (2000), cette forme pourrait provenir du nom de personne Caro, un saint venu de la Bretagne insulaire au VIe siècle, cela semble incertain pour J.-Y Le Moing (2004). Ce nom est très présent dans le sud de l'ancien diocèse de Saint-Malo, et dans l'est de celui de Vannes, par exemple Caro où la Chapelle-Caro. Des formes anciennes Caroth (833) et Karou (1330) sont attestées. Ce nom peut être rapproché, d'après H. Abalain, du breton karv, "cerf". J.-Y Le Moing ne propose pas ce rapprochement,,.
L'Office public de la Langue bretonne (Kerofis) propose le néotoponyme breton Porzh-Karozh.
Histoire
Préhistoire et Antiquité
Le terroir de Porcaro a été habité dès la Préhistoire, puis par les Celtes et ensuite par les Romains.
Moyen-Âge
Le château des Touches aurait été construit initialement par le duc de Bretagne Jean II en 1130 ; celui-ci en aurait fait don au seigneur du Losquet.
Temps modernes
Porcaro était le siège de deux seigneuries importantes, Le Breuil et Porcaro, dont en 1628 la réunion fit de Porcaro le siège d'une haute justice.
Porcaro était une trève de la paroisse de Guer. La chapelle Saint-Sébastien, bâtie non loin du château de Porcaro, dont elle avait dépendu primitivement (une chapellenie y fut fondée par les seigneurs de Porcaro le ), fut chapelle frairienne.
Plusieurs chapelles existaient alors : la chapelle Saint-Mélan (disparue), la chapelle Sainte-Anne-des-Touches, la chapelle de Porcaro (chapelle Saint-Sébastien, dans laquelle fut inhumée Madeleine Morice, reconstruite entre 1830 et 1843).
Le XIXe siècle
La création de la commune
Porcaro est constituée en paroisse le ; la construction de l'église paroissiale Notre-Dame est décidée le à l'initiative de M. de Plouër, alors propriétaire depuis 1836 du château de Porcaro, et les travaux, poursuivis par sa veuve après le décès du vicomte, sont achevés en 1849 ; elle poursuit aussi dès 1848 les démarches visant à l'autonomie totale de Porcaro.
En 1858 les habitants de la section de Porcaro, alors dans la commune de Guer, demandent ä constituer une commune, en ajoutant à leur section des territoires appartenant aux communes de Monteneuf et Augan; ils arguent que le bourg de Guer est éloigné de 8 km de leur église succursale. Les communes de Guer, Monteneuf et Augan s'opposent énergiquement à cette demande qui est alors refusée par le Conseil général du Morbihan.
Le conseil municipal de Guer prétend même que Porcaro ne va « pouvoir produire ni maire, ni adjoint et encore moins un secrétaire : entendez par-là qu’il faut savoir lire et écrire » et que « cette création est le résultat d’une ambition, celle de Madame de Plouër, châtelaine de Porcaro ».
Mais Madame de Plouër a des relations haut placées et Porcaro est érigée en commune constituée de hameaux et de terres prises à Guer, Augan et Monteneuf le , ce qui entraîne l'essor de l'agglomération de La Belle Alouette, formée à la fin du XIXe siècle, qui s’est développée aussi grâce à l’exploitation des ardoisières et à la proximité par la suite du camp de Coëtquidan.
L'ardoisière (des schistes précambriens) de Saint-Mélan ouvre vers 1860 ; elle est rachetée le par Ferdinand Ubermuhlen, puis en 1892 personnes la comtesse de Chausy et au début du XXe siècle par M. Guyomarch ; exploitée à ciel ouvert, le trou d'exploitation atteint 49 mètres de profondeur ; en 1911 elle emploi une quinzaine d'ouvriers dont six mineurs ; sa date de fermeture est inconnue ; c'est de nos jours un plan d'eau de forme circulaire.
Le champ de tir de Coëtquidan
C'est en 1873 que le ministre de la guerre fait étudier le projet d'un champ de tir sur la lande de Coëtquidan, les portions de lande à occuper momentanément dépendant des six communes de Guer, Augan, Porcaro, Saint-Malo-de-Beignon, Campénéac et Beignon. « Elles se composent, dans les cinq premières, de terrains communaux que les municipalités s'étaient empressées de mettre à la disposition de l'administration de la guerre, moyennant la concession de certains avantages, notamment des fumiers. Mais, dans la commune de Beignon, la négociation avait été plus difficile parce que les terrains y étaient devenus l'objet d'un partage consommé entre les habitants, et qu'on avait à traiter avec un plus grand nombre d'individus ».
La création en 1878 (décret d'utilité publique en date du et jugement d'expropriation en date du par le tribunal d'instance de Ploërmel) du champ de tir de Coëtquidan se fait pour partie dans la partie nord du territoire communal.
La fin du XIXe siècle
En 1872 la tour de l'église paroissiale menace de tomber en ruines et d'entraîner dans sa chute une partie de l'église ; la comtesse de Chausy offre de financer une partie des travaux ; le conseil général accorde une subvention, « la commune de Porcaro étant sans ressources ».
En 1880 « la construction de l'école des garçons avance rapidement », la commune ne disposant jusqu'alors que d'une école mixte congréganiste. L'école des filles, jusqu'alors tenue par des religieuses, est laïcisée vers 1890 et installée alors dans une maison louée à cet effet, mais ne convenant guère à cet usage. En 1901, le préfet du Morbihan impose la construction d'office d'une nouvelle école des filles à la commune qui s'y refusait.
Le XXe siècle
La Belle Époque
L'ouverture le du tronçon Ploërmel-Messac, via Guer et Maure, de la ligne ferroviaire allant de Châteaubriant à Ploërmel permet la desserte de Porcaro, qui dispose d'une halte ferroviaire.
La Première Guerre mondiale
Le monument aux morts de Porcaro porte les noms de 47 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 3 sont morts en Belgique (Jean Plantard dès le à Fosses, Théophile Coric et Joseph Morin le à Maissin) ; Eugène Thommerot, zouave de l'Armée d'Orient, mort de maladie le dans l'actuelle Macédoine du Nord et décoré de la Croix de guerre pour avoir fait acte de bravoure lors d'un combat ; tous les autres sont morts sur le sol français (dont Joseph Le Peintre (décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, Pierre Danion, Joseph Labbé et Joseph Thomas, tous les trois décorés de la Croix de guerre ).
Le camp de Coëtquidan
Les expropriations provoquées par l'extension du camp de Coëtquidan aux alentours de 1910-1912 provoquèrent un véritable traumatisme dans la région : 400 habitants et 2 000 hectares (en réalité 1 640 hectares) de terres furent expropriés à Beignon ; à Campénéac (30 % de la superficie de la commune), Augan et Porcaro près de 5 000 hectares ont été frappés d'expropriation. « Le château du Bois-du-Loup, valant 1 million [de francs] a été abattu à coups de canon (..) Les villages de Montervily, Le Faou, Launay-Salmon, Lépinay, La Ville-Quignon, La Ville-Lhèle sont tous dévastés. Les anciens propriétaires de ces maisons ont tiré le meilleur parti possible des boiseries, portes et fenêtres ; le génie qui a pris possession de toute cette contrée a emporté le reste : poutres, etc.. (..) Plus loin, nous entrons dans la chapelle Saint-Mathurin, de style roman. Les portes sont brisées ; plus d'autel, plus un seul vitrail ; les dalles ont été enlevées (..). Il en est de même, paraît-il, des chapelles de Saint-Méen et de Sainte-Reine, où tous les ans, jadis, les foules venaient en pèlerinage ». En octobre 1914 de faux bruits accusèrent à tort des prisonniers de guerre allemands, hébergés à Saint-Malo-de-Beignon, d'être les auteurs de ces destructions.
La création du camp de Coëtquidan entraîne l'occupation par celui-ci de 477 hectares, soit près du tiers de la superficie communale.
En 1912 « les cultivateurs de Porcaro, Augan, Campénéac, Guer, Saint-Malo-de-Beignon demandèrent l'autorisation de faire paître leurs bestiaux sur les landes expropriées pour l'extension du camp de Coëtquidan, et de continuer à faire usage des mares, pièces d'eau et sources situées sur les terrains militaires récemment acquis pour y abreuver leurs bestiaux et pour leurs besoins domestiques » ; le ministre de la guerre fit répondre qu'« il y aurait de graves inconvénients à rapporter ces interdictions (..) sauf à titre exceptionnel ».
Une réunion organisée le , réunissant des autorités militaires, l'ingénieur des Ponts et Chaussées de Pontivy et les maires de Beignon, Saint-Malo-de-Beignon, Campénéac, Augan et Guer précisa les modalités d'interruption du trafic routier lors des séances de tir dans le camp de Coëtquidan, concernant notamment la route nationale 24 (dont le tracé d'alors passait par Campénéac et Plélan-le-Grand via Beignon et Trécesson) et les routes d'intérêt local « de viabilité médiocre [où] la circulation rurale est beaucoup plus importante que la circulation automobile » comme les axes Augan-Beignon et Porcaro-Beignon. En 1929 les élus locaux demandent une restriction des interdictions.
L'Entre-deux-guerres
En 1922 il existe une classe unique à l'école publique de garçons de Porcaro.
Le une réunion pour la création d'un syndicat agricole est organisée à Porcaro.
Le le meurtre du père Bécel traumatise les habitants et ce meurtre fait l'objet de plusieurs articles de presse. Porcaro est alors ainsi décrit en 1930 :
« Un village caché au milieu de la lande ; seul le clocher de la vieille église émerge dans le lointain, au-dessus des genêts géants ; sur la place, une maison basse sur laquelle sont placardées des affiches blanches officielles : la mairie et l'école. Tout autour, disséminées sans souci d'alignement, le long des chemins creux bordés de haies vives, quelques fermes. Nous sommes à Porcaro.. Quelques centaines d'habitants vivent là, tranquilles et calmes, depuis des siècles. »
La Seconde Guerre mondiale
Le monument aux morts de Porcaro porte les noms de 5 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Henry de L'Estourbeillon, capitaine, tué à l'ennemi le (décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre) et Lucien Robert, soldat tué à l'ennemi le , tous les deux lors de la Bataille de France ; Jean Loeillet, parachutiste au 2e régiment de chasseurs parachutistes, fusillé le à Elp (Pays-Bas) ; Joseph Thommerot, résistant, mort le au camp de concentration de Neuengamme (Allemagne) ; Yves Corbel, mort en 1944.
L'après Seconde Guerre mondiale
Le monument aux morts de Porcaro n'a été édifié qu'en 1961 ; sa statue représente un soldat des Forces françaises libres et non un poilu comme c'est souvent le cas pour les monuments mis en place après la Première Guerre mondiale.
Le tronçon de Guer à Ploërmel de la ligne ferroviaire de Châteaubriant à Ploërmel (PK 426,500 à 448,900) ferme le .
Le Pardon des motards
À l'initiative de l'abbé Louis Prévoteau, motocycliste lui-même, le pardon de Porcaro est depuis 1979 un lieu de ralliement et de pèlerinage pour de nombreux motards qui viennent le vénérer la Madone des motards, ramenée par l'abbé de Notre-Dame-de-Fátima (Portugal). Le pèlerinage a débuté avec 38 motards et a depuis attiré un nombre croissant de motards jusqu'à atteindre les 30 000 ces dernières années, devenant ainsi le plus grand pèlerinage de motards et l'un des plus grands rassemblements de motards en Europe.
Un concert de rock se tient traditionnellement la veille du pardon, ce dernier étant suivi par une procession à moto de 80 kilomètres (soit 2 heures d'un flot continu de motards) sur les routes de la région, spectacle auquel assistent de nombreux curieux.
Politique et administration
Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1861. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006.
En 2022, la commune comptait 749 habitants, en évolution de 3,74 % par rapport à 2016 (Morbihan : 3,82 %, France hors Mayotte : 2,11 %).
Enseignement
Culture et patrimoine
Lieux et monuments
- le château des Touches date pour partie du XVIe siècle et pour partie du XIXe siècle ; il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel ;
- le château de Porcaro : le bâtiment actuel date de 1860, mais s'appuie sur l'ancien manoir précédent qui datait de la première moitié du XVIe siècle, lui-même construit sur un site déjà mentionné au XIIIe siècle ; la chapelle date de 1830 ;
- l'église Notre-Dame, construite vers 1848. Elle possède un mobilier religieux répertorié (ciboires, calice, patène, ostensoir, pupitre, navette à encens, Christ en croix, etc..) ainsi que 4 autels, 3 stalles et 3 retables de style néogothique.
- La chapelle Sainte-Anne des Touches (XVIIe siècle) en schiste et ardoises ; elle possède notamment un groupe sculpté représentant sainte Anne et la Vierge.
- des croix de chemin : celle de Vautoudan (XIIIe siècle ou XIVe siècle) ; celle de Porcaro, qui date probablement du XVIIIe siècle ; celle de la Renay, aussi du XVIIIe siècle et plusieurs autres.
- un petit sanctuaire marial (une copie de la groote de Lourdes)
- Le moulin de Malakoff (XIXe siècle).
Héraldique
Légende
- Le chasseur fantôme de Porcaro, publié e pour la première fois en 1913 par François Cadic.
Personnalités liées à la commune
- La famille de Porcaro, qui fait partie des familles subsistantes de la noblesse bretonne, est originaire de la commune au XVe siècle. À cette famille appartient l'abbé Pierre de Porcaro, mort le au camp de concentration de Dachau.
- Madeleine Morice (née le ä Néant, décédé le à Porcaro, alors en Guer), surnommée la "sainte de Porcaro" ou l'"extatique de Bretagne" car elle portait les stigmates de la Passion du Christ.
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des communes du Morbihan
- Ligne Châteaubriant - Ploërmel
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Insee (communes)
- Ldh/EHESS/Cassini
- Ressource relative à plusieurs domaines :
- Annuaire du service public français
- Porcaro sur le site de l'Institut géographique national
- Portail des communes de France
- Portail du Morbihan